Divers
Vitry-sur-Seine, Benacquista
VITRY-SUR-SEINE
La communale et la télé
par Tonino BENACQUISTA
(extrait)
Ma maison était sise au 9 de la rue Jean-Roche, adjacente à la rue Anselme-Rondenay. Je suis né tout près de là, à la clinique de Choisy-le-Roi, en 1961. La banlieue avait déjà perdu son charme, son identité, ce n’était déjà plus du Doisneau. Les architectes, encouragés par les promoteurs, eux-mêmes encouragés par les élus, ont urbanisé cette contrée à outrance et lui ont fait perdre son âme. Le petit quartier pavillonnaire où j’habitais était entouré de cités dortoirs, un décor triste qui n’a pas changé depuis. À l’époque, les Italiens mettaient un point d’honneur à ne jamais vivre en HLM, ils parvenaient tous à se construire une maison, on ne savait pas trop comment. Elles poussaient à toute allure, des copains d’usine venaient donner un coup de main. Je me souviens d’avoir laissé un terrain vague à quelques mètres de chez moi avant de partir un mois en Italie ; au retour, un pavillon se dressait là, tout pimpant. Un petit miracle. Il est vrai que les Italiens ont toujours été «du bâtiment»… Ils avaient réussi à se construire une «Little Italy» rien qu’à eux. C’était notre rue.
L’histoire que je relate dans La Commedia des ratés est celle d’un gosse de la deuxième génération désorienté par sa double culture. Enfant de Rital, j’ai cherché, à l’âge adulte, le Rital en moi. Et j’en ai fait un roman. Je suis le seul de mes frères et soeurs à être né sur le sol français, ça aide. Ma famille venait du petit village de Sora entre Rome et Naples. Dans la dernière vague d’émigration italienne, vers les années cinquante, les familles du coin savaient qu’on embauchait, en France, dans une petite usine de bateaux à Vitry, tenue par un Italien. Tous se sont mis à arriver, les uns après les autres. Comme la plupart des pères, le mien a fait le voyage en premier, histoire de trouver de quoi loger le reste de la famille et mettre un peu d’argent de côté pour les accueillir. Ma mère, mon frère, mes soeurs, et mon grand-père, l’ont rejoint un an plus tard. Mon père, aujourd’hui décédé, et ma mère étaient restés très «italiens» – ils ont toujours gardé un fort accent, et parlaient une langue mélangée de français et de dialecte, pleine de barbarismes – sans plus l’être totalement. Quand ils retournaient en Italie, on les reconnaissait comme français. C’est le paradoxe de tous les immigrants, n’être chez soi nulle art.
On parlait l’italien à la maison et dans le quartier, mais ça n’a pas été un handicap. J’ai appris le français à la communale, cette grande et belle invention qui donne sa chance à tous. J’y ai même appris l’italien, celui de Dante ! En classe de 4e, au CES Jules-Vallès, un cours d’italien s’est ouvert en 1974. Nous étions six ou sept à l’avoir choisi comme seconde langue, croyant que ça nous donnerait des points faciles au bac. On ne se doutait pas que c’était une vraie langue, à la grammaire complexe, et pas ce dialecte informe que nous parlions. Parmi les élèves, certains ne pensaient déjà qu’à retourner là-bas. J’ai toujours trouvé bizarre cette nostalgie d’une terre que l’on n’a pas connue. Une de mes soeurs est repartie vivre à Sora, comme elle l’avait toujours souhaité. Ma soeur Anna était une surdouée, il lui avait fallu moins d’un an pour maîtriser parfaitement le français et devenir une des meilleures élèves du Val-de-Marne. Elle avait eu droit à un baptême de l’air et à sa photo dans le journal. Celle qui s’était le mieux adaptée est retournée vivre là-bas, je ne saurais dire pourquoi. Mes trois autres frère et soeurs sont restés en France. Hélas, mon père n’avait pas les moyens de les laisser continuer en classes secondaires : mon frère a été ouvrier à 14 ans, mes soeurs ont suivi les cours Pigier juste après le certificat d’études. J’avais la chance d’être le plus jeune, et quand les grands ont quitté la maison, j’ai pu aller jusqu’au bac. Je me souviens qu’à l’époque mes soeurs avaient une petite machine à écrire sur laquelle elles s’entraînaient pour devenir dactylos. Je l’utilisais dès qu’elle était rangée dans un coin. J’avais envie d’écrire, de raconter. Au lycée, j’ai rencontré un surveillant qui lui aussi écrivait, Jean-Bernard Pouy, natif de Vitry. Il m’a encouragé, il m’a permis «d’y croire» et j’ai persévéré. Vers l’âge de vingt ans, j’ai vite lâché de vagues études pour gagner ma vie et écrire en parallèle. J’ai eu un job dans les trains de nuit qui me laissait le temps d’écrire pendant les jours de récupération. J’ai relaté cette expérience dans La Maldonne des Sleepings, en 1988. Puis les boulots se sont enchaînés, me donnant parfois des toiles de fond pour mes romans.
[…]
Extrait de l’ouvrage : Balade en Val-de-Marne, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, mars 2002
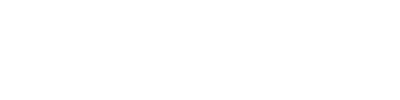
Bonjour Madame, Monsieur,
Je m’appelle Pierre Francis Di Cesare, et je souhaiterais si cela était possible obtenir l’adresse mail de Monsieur Tonino Benacquista.
J’ai 66 ans, né en France, je vis actuellement à Marseille. Comme lui je suis originaire d’Italie plus précisément de Serracapriola province de Foggia.
J’ai grandi dans une atmosphère familiale où la violence verbale et physique était omniprésente, avec pour seuls moyens de communiquer avec mes parents, l’usage de dialectes.
Je serai très heureux de pouvoir échanger quelques lignes avec Monsieur Benacquista.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame,Monsieur,
L’ expression de mes sentiments les meilleurs .
Pierre, Francis Di Cesare.
merci de votre intérêt pour notre travail
vous pouvez joindre M Benacquista par l’intermédiaire de son éditeur Gallimard
bien à vous
alexandrines