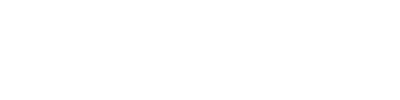Le Calvados des écrivains
Patrick Grainville à Villerville
VILLERVILLE
Une enfance en féerie
par Patrick GRAINVILLE
(extrait)
Mes rapports avec le pays natal ne sont pas aussi lisses qu’il y paraît. Mais ambivalents, mêlés. Je suis né embusqué dans l’estuaire de la Seine, empêtré. Les prairies normandes manquaient parfois, à mes yeux, d’espace. J’avais soif d’une aventure ouverte, large, épique. Et je n’étais pas sans partager les mélancolies et les chimères de Madame Bovary. Certes, il y avait eu l’avènement primordial des Vikings et cela faisait souffler sur les parcelles normandes un vent plus tonique. L’estuaire s’ouvrait sur la mer et j’avais besoin de cette promesse d’envol, de voyage, d’élargissement. Parfois, je souffrais d’être un peu trop enfermé dans la commissure de l’estuaire et que le Havre soit à ce point encombré de citernes, d’usines. Je rêvais d’une rive vierge, sauvage.
C’est pourquoi mes romans normands sont tous liés à des circonstances paroxystiques. L’Orgie, la neige au grand hiver de 62. La Diane rousse à l’été 76. J’aimais les métamorphoses brutales de ma terre. Quand la neige ou la canicule l’ouvraient, l’exaltaient, la transfiguraient. Alors, c’était le Grand Nord ou l’Afrique. Déjà mes thèmes de prédilection. J’aimais la Normandie secouée, en crise, plongée dans des effervescences libératrices.
Enfant, j’attendais les premières chutes de neige avec une soif, un lyrisme inouïs. La neige était un personnage, une héroïne épique, ardente. Une tempête qui brouillait les frontières des propriétés closes, qui effaçait toutes les limites. J’adorais l’illimité. La neige recouvrait tout, unifiait, subvertissait, élargissait. L’aventure était mon obsession chevillée. La neige était nomade, conquérante, elle déferlait de l’ouest, de la mer, des lointains ou du Nord. Elle fécondait mon sol de ses images vives, démesurées. J’allais à la chasse avec mon père. Il avait un sens magique de la neige, de l’animal sauvage, de l’oiseau de passage. Un sens homérique, onirique. Tous deux nous attendions la neige comme une résurrection, l’arrachement au quotidien, aux nuances douceâtres du paysage. Nous aspirions à l’âpreté, à la flamboyante rigueur de l’hiver, à son alchimie rude et précieuse. Nous parcourions, dans la fièvre, des immensités blanches. Complices. Dans l’attente des bandes d’oiseaux qui allaient remplir et fleurir le ciel : les pluviers dorés, les vanneaux, les sarcelles, les cols-verts. Nous avions un sens quasi totémique des animaux. Nous en parlions comme de fabuleux visiteurs. Les poursuivre, les tuer, c’était surtout les rencontrer, les toucher, s’assurer de leur présence, de leur pouvoir. C’était vraiment le temps des croyances. Le monde était enfin habité. J’étais envahi, possédé par un sentiment de présence presque sacré. Mon père, moi, le paysage, les animaux ne formions plus qu’un bloc vivant, vivace, mystérieux, enchanté et violent. Oui, c’était l’avènement de la vivacité. La vie enfin vive.
[…]
Extrait de l’ouvrage : Balade dans le Calvados, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, mai 2004