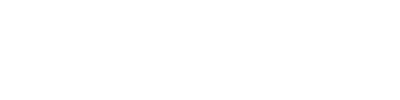Balade dans les Ardennes
Frédérick Tristan à Ville-sur-Lumes
VILLE-SUR-LUMES
L’Ardenne chinoise de Frédérick Tristan,
par Jean-Luc MOREAU
« Écrire fut pour lui plus qu’une fête de l’esprit :
un engagement de tout l’être. Il y eut pour lui,
dans l’écriture, quelque chose d’aventureux et d’un
peu chevaleresque, comme pour la délivrance,
au loin, de belles et jeunes captives sous les chaînes… »
Saint-John PERSE
À la mémoire de Valéry Larbaud
Si Frédérick Tristan ne fait pas mystère de ses origines ardennaises, et s’en réclame même volontiers, rien ne les laisse transparaître dans son œuvre, semble-t-il, pas plus les lieux évoqués ou décrits que les personnages mis en scène. C’est qu’il ne se livre à l’autobiographie dans aucun de ses ouvrages, pourtant au nombre d’une quarantaine, romans ou essais. Il semble même fuir toute référence à sa personne ou aux conditions contingentes de sa propre existence. Et cela va si loin que tout se passe chez lui au loin, justement, ou du moins ailleurs, en Europe parfois, en Chine assez souvent, de temps à autre au ciel ou en enfer, mais en France, pour ainsi dire jamais.
Il faut voir dans ce dessaisissement l’un des moteurs de sa création littéraire. « N’est-il pas nécessaire à un écrivain d’utiliser un registre d’identités qui, le libérant de son ego, lui permet d’endosser les caractères et les tempéraments les plus divers, voire les plus opposés? ». Presque chacune de ses fictions est rapportée, contée, voire écrite, par un narrateur particulier, relevant d’une autre culture que la nôtre, et saisi à travers elle ou à travers ce que l’on peut en imaginer. Une telle œuvre romanesque offre un faisceau de perspectives certes singulières, mais toutes emblématiques, et se présente comme une sorte d’utopie encyclopédique de l’imaginaire.
S’affranchir ainsi des déterminations premières, c’est remettre en cause notre révérence habituelle à l’égard de nos origines, de nos « racines ». Il s’agit d’une revendication de totale liberté pour l’homme, dont le devoir serait de nier ses propres limitations, mais aussi celles de l’évidence ou de la logique, pour défier l’impossible, assumer le contradictoire. C’est l’un des thèmes constants de l’œuvre. Mais on peut aussi reconnaître en l’homme essentiellement un égaré. Sans cesse en quête de son origine, de son nom comme de son lieu, la mort le saisit dès qu’il s’identifie à ceux que le hasard lui a donnés ou qu’il prétend avoir trouvés. « Je est un autre », écrit Rimbaud. « Penser, ou dire, ou croire « je suis », « moi », ce n’est pas être ; être soi », écrit Daumal. Quant à Frédérick Tristan, il écrit Le journal d’un autre. Entre Ardennais on se comprend, apparemment.
C’est en 1983 qu’il reçoit le prix Goncourt, pour son huitième roman, Les Égarés. Le personnage principal, Jonathan Absolon Varlet, est amené à poursuivre la quête douloureuse de ses véritables origines et ne trouvera son nom qu’à l’instant de sa mort, après s’être dépouillé de ses différents masques, choisis ou imposés. Ce prix Goncourt confère la notoriété à un auteur que la critique avait déjà plusieurs fois salué comme l’un des plus singuliers de la littérature française contemporaine. Les nombreux articles qui paraissent à cette occasion le font naître le 11 juin 1931 à Sedan. Ce n’est pas tout à fait exact. Son nom apparaît pour la première fois vers 1948, sur la couverture d’une plaquette de poèmes. Jusque là, il n’existait pas. Celui qui est né dix-sept ans plus tôt dans les Ardennes, c’est un certain Jean-Paul Baron, dont il est l’autre écrivant, et imaginaire. Mais pour plus de commodité, oublions pour un instant cette distinction essentielle.