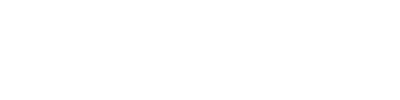Le Nord des écrivains
Marie Desplechin à Roubaix
ROUBAIX
Le Nord de mon enfance,
par Marie Desplechin
(extrait)
À l’époque glaciale des étrennes, le facteur passait dans chaque maison pour vendre le calendrier des Postes. On trouvait, sous sa couverture rectangulaire et cartonnée, après la liste des départements, un plan de la ville. Si j’avais planté la pointe d’un compas sur ma maison et tracé un cercle autour d’elle, j’aurais entouré ma vie. Quelques centaines de mètres et le tour était fait.
Le Nord qui est mon pays tient dans un cercle dont le périmètre n’excède pas mille mètres. Il est à cheval sur deux cités, Roubaix et Croix, l’une plus grande et l’autre plus petite, toutes deux insérées dans le tapis urbain de la conurbation qui s’étend autour de Lille.
Lille, nous y allions rarement. Roubaix, qui était encore dans les années soixante une grande ville (je parle du siècle dernier), offrait tout ce qu’il fallait. Nous n’avions pas besoin de voiture pour faire nos courses, nous rendre à la piscine ou à la bibliothèque, assister à la messe dominicale. Mes grands-mères habitaient à moins de cinq cents mètres de chez nous, ainsi que mes oncles et tantes, mes cousines et mes cousins. Ceux qui s’étaient exilés avaient fait construire à Hem. Aller à Hem était dépaysant. Hem avait quelque chose de rafraîchissant, de bucolique, de propice aux dimanches.
Chaque matin, dix ans durant, sur le chemin de l’école, puis du lycée où j’ai fait mes études, je suis passée devant la clinique où je suis née. Si j’avais fait un détour de quelques dizaines de mètres, j’aurais longé la maison où est né mon père. Et quelques dizaines de mètres encore, celle où est née ma mère. Les églises de nos baptêmes, de nos communions, de nos mariages, jalonnaient le trajet. Sur la route, des commerces implantés depuis si longtemps qu’ils ne perdaient jamais, pour leurs clients, le nom de leurs premiers propriétaires. L’histoire, dans le pays où j’ai grandi, était une géographie. Une géographie que l’on retenait avec les pieds. Ici, carrefour de la Croix Blanche, prises dans le revêtement du trottoir, les empreintes de monsieur Poupoune, le chien de ma grand-tante Rosaimée. Là, au milieu du parc de la Mairie, le kiosque où les Allemands avaient rassemblé les otages raflés dans l’avenue. Là encore, le mur aveugle de briques noires devant lequel mon père attendait que ma mère sorte du travail, à l’époque de leurs fiançailles. Tout cela avait eu lieu bien avant que nous en soyons. Mais tout cela nous appartenait comme si nous l’avions vécu. Tout cela était aggloméré à nos souvenirs d’enfants, faisant de nos mémoires un ensemble vaste et imagé qui nous comprenait, et s’étendait bien au-delà de nous.
[…]
Extrait de l’ouvrage :Balade dans le Nord, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, février 2005