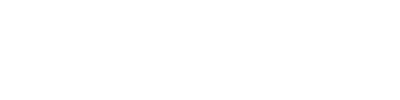Divers
Préface par Christian Guidicelli
Une séduction secrète
(extrait)
Lorsqu’on naît à Nîmes, on se sent à moitié romain : c’est presque une vérité de La Palice. Enfant, j’ai joué dans les jardins de la Fontaine, à deux pas des ruines du temple de Diane propres à inspirer un Hubert Robert. Plus tard, lycéen (étudiant le latin, bien sûr) en quête de bonnes fortunes, j’arpentais le dimanche ce boulevard Victor-Hugo qui aboutit d’un côté aux arènes, de l’autre à la Maison carrée. Les arènes m’impressionnaient par leurs dimensions, la belle régularité de leurs arches superposées. Elles m’inquiétaient aussi car j’imaginais que s’y étaient déroulés de tragiques spectacles avec lions déchaînés et gladiateurs agonisants, préludes à ces modernes corridas qui en remplissent les gradins à Pentecôte. La Maison carrée en revanche me procurait un plaisir sans cesse renouvelé, celui qu’offre un chef-d’œuvre de grâce, à l’équilibre si parfait qu’il paraît aller de soi, donc inanalysable avec les mots ordinaires de la critique. Stendhal l’a bien compris, qui dit qu’elle est « comme le sourire d’une personne habituellement sérieuse ». Voilà la meilleure des définitions, née de l’intuition plus que de l’examen. Et pour cause : l’auteur de la Chartreuse de Parme ne semble jamais avoir mis les pieds à Nîmes.
Certains, et non des moindres, que vous retrouverez au fil des pages de ce livre – Apollinaire, Marc Bernard, Jean Paulhan… – se sont promenés avec délice dans les rues de la Rome française. Ils en sont partis un jour suivre ailleurs leur destin. Le monde – peut-être a-t-on tort de le penser – ne se limite pas à un lieu unique, fût-il une ville privilégiée.
Mes premières fugues, avec des camarades de classe, me conduisirent en scooter jusqu’à la mer, vers ce Grau-du-Roi qui n’était pas encore une station balnéaire très fréquentée. Dès le mois de juin, nager dans une eau juste fraîche puis courir sur le sable de la longue plage du Boucanet signifiait un acte de libération. Non que je me sois senti prisonnier à Nîmes, juste un peu à l’étroit, surveillé. La famille de ma mère étant cévenole et protestante (presque un pléonasme), ceci explique en partie cela. J’admire, à bien des égards, le protestantisme et son histoire, moins les leçons qu’il m’arriva d’en recevoir. Je me souviens d’une vieille cousine qui vivait au Pompidou dans une maison délabrée mais impeccablement propre. Une fois, alors que je me penchais pour l’embrasser avant de prendre congé, elle me glissa à l’oreille avec autant de gentillesse que de fermeté : « Quand tu te marieras, essaie de choisir une jeune fille de notre religion. » La pauvre serait déçue… Mes copains parpaillots n’avaient rien de désuet. Ils n’embêtaient pas le monde avec leurs peines de cœur et, à supposer qu’ils en aient souffert, ils se seraient cachés pour pleurer. Ils étaient fiers comme tous les minoritaires, agaçants par leurs certitudes, merveilleux par leur volonté : « Ne désespère pas, petit troupeau », dit l’Évangile.
[…]
Extrait de l’ouvrage : Balade dans le Gard, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, mai 2008