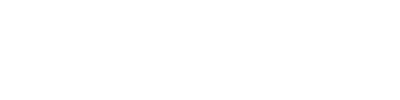Le Calvados des écrivains
Jérôme Garcin au Pays d’Auge
PAYS D’AUGE
Je suis de ce pays
par Jérôme GARCIN
(extrait)
Longtemps, j’ai négligé la Normandie. J’y avais pourtant passé toutes mes vacances d’enfance et d’adolescence. J’en avais gardé le souvenir très vif de persistants parfums, un mélange d’algues et de noisettes, de pommes à couteau et de crevettes grises ; le souvenir, aussi, d’une mélancolie douce que la pluie fine attendrissait et, parfois, excusait.
C’était, dans le Bessin, à Saint-Laurent-sur-Mer, où mes grands-parents paternels (mon grand-père, né en Martinique, ma grand-mère, d’origine normande) possédaient une maison tout en longueur et en blancheur. Elle était située à côté d’une ferme qui fut mon école buissonnière (c’est là que, sans le savoir, je suis devenu colettien) et à quelques kilomètres de la mer, une mer que j’ai toujours aimé regarder mais dans laquelle je n’ai jamais aimé me baigner. La Manche, dont le vert tirait sans cesse vers l’anthracite, m’était hostile.
Ce n’était pas seulement qu’elle fût trop froide à mon goût, c’était aussi qu’elle continuait chaque jour de charrier, par vagues successives, des morceaux de guerre, des lambeaux de mort. Dans un bruit d’orage qui gronde, des bateaux amphibies n’en finissaient pas d’aller repêcher sous mes yeux écarquillés toute la ferraille du débarquement, des cadavres de navires, d’étranges sculptures militaires rouillées par l’oubli, des armes, des bombes, des casques, d’affreux et contondants appâts. Omaha Beach, à la fin des années soixante, n’était plus une bataille, n’était pas encore un sanctuaire : c’était, entre l’effroi d’hier et le recueillement de demain, une plage blessée, qui saignait toujours et pleurait sous la bruine.
J’ai quitté la Normandie à la fin de mon adolescence, après la mort de mes grands-parents, qui sont enterrés dans le cimetière de Saint-Laurent. J’avais beaucoup lu Stendhal, et j’avais soudain besoin de soleil, d’Italie et de Midi. J’ai suivi les lignes du cœur, rencontré celle qui allait devenir ma femme, Anne-Marie Philipe, et trouvé dans sa maison de Ramatuelle, au milieu des vignes et des pins parasols, ce qui se rapproche le plus du bonheur de vivre. Être nu sous le soleil brûlant, insoucieux dans une mer tiède et indulgente, dormir la fenêtre ouverte sur les branches du platane, écouter la nuit stridente au creux d’un hamac, tout cela, qui m’était si étranger, je crois bien que je l’ai savouré en normand. En sachant que c’étaient une félicité provisoire, un éblouissement qui m’était accordé, une lumière qui m’était prêtée, une parenthèse.
[…]
Extrait de l’ouvrage : Balade dans le Calvados, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, mai 2004