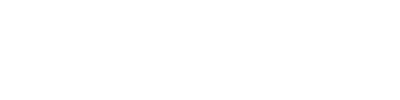Divers
NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU Duras
NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU
Nos maisons de Neauphle
Par Michèle MANCEAUX
(extrait)
En 1958, Marguerite Duras vend au cinéma les droits de son livre Un barrage contre le Pacifique qui a failli obtenir le prix Goncourt. Elle le recevra, ce prix, près de trente ans plus tard avec L’Amant. Entretemps, elle vit dans cette maison de Neauphle-le-Château qu’elle a achetée avec l’argent du Barrage. Elle vit modestement, traverse des périodes de grande solitude mais, juste retour des choses, elle a récupéré du terrain contre les terres inondées d’Indochine où sa mère avait tout perdu. Revanche : sa maison fait face au château d’eau.
Un instinct très sûr guide Marguerite vers la beauté et le talent. Elle a découvert le joli village de Neauphle perché sur sa colline, lors d’une promenade en voiture. Elle est rêveuse, lyrique. Elle aime entraîner dans son sillage ceux qui l’écoutent. Au théâtre de l’Athénée où l’on joue son adaptation de La Bête dans la jungle, elle convainc la comédienne Françoise Spire d’acheter aussi une maison à Neauphle ; puis, moi, dans la même rue de la Gouttière qui communique directement avec la rue du Docteur-Grellière où sa propriété s’étale devant l’école et le monument aux morts. Maison de douanière qui lui va bien. Marguerite, en sentinelle, surveille les enfants et les morts.
Pendant trente années de voisinage, nous avons monté et descendu la sente du Vieux-Moulin qui relie nos deux maisons. Nous ne nous disputions jamais. « Impossible, dit-elle, nous sommes dans une nécessité géographique. » — J’aime ses énoncés souvent surprenants. Nous finirons quand même par nous brouiller, mais trente années ne s’effacent pas.
Après sa mort, je m’enferme dans ce voisinage et j’écris le récit de notre amitié «géographique». Ce fut aussi une affection, en tout cas de ma part, je ne saurais rien affirmer de la sienne. Au cours de ce travail intitulé L’Amie1, j’ai tenté de retrouver, de revoir Neauphle avec elle.
Elle me dit : « Toi qui habites dans le trou… »
Je souris d’autant plus que sa maison donne sur la route et que, curieusement, c’est de mon grenier que la vue s’étend sur la plaine. Cependant cette étrange configuration des lieux symbolise assez bien nos positions amicales. Elle, incontestablement en haut, et moi, en bas. Mais j’aime la regarder et elle aime que je la regarde. Je ne suis ni humiliée ni blessée. Le recul me permet, en général, de ne presque pas sentir les coups et d’applaudir aux comédies. En l’occurrence, c’est un opéra. Exceptionnel, surprenant, magnifique, éclairant. Pendant une trentaine d’années, Marguerite ne cesse de m’éblouir. Elle m’apprend le principal, elle m’apprend justement à regarder. Elle m’apprend aussi à perdre mon temps. « Le temps perdu est le temps de l’écriture. » On m’a enseigné dès l’enfance un principe contraire : l’oisiveté nocive, stérile. Or, je l’observe pendant des heures, tassée dans son fauteuil d’osier, seule au milieu de la pièce, laissant venir l’obscurité ou bien déjà dans le noir. Sa concentration m’impressionne. En la regardant vivre, j’apprends ce qu’est un écrivain. Elle sait que rien ne m’intéresse autant. Je me sens privilégiée de vivre près d’une personne qui me fait rire et réfléchir.
[…]
Extrait de l’ouvrage : Balade en Yvelines, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, mars 2011.