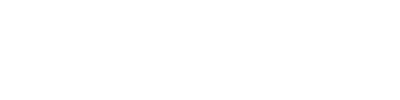Balade dans les Ardennes
Julien Gracq à Monthermé
MONTHERMÉ
Une journée d’automne
par Hervé CARN
(extrait)
Les Ardennes ont toujours été une terre d’accueil. On dirait que ses habitants veulent tendre la main au passant et se sentir plus forts pour être à la hauteur des paysages. La population des Ardennes s’est renouvelée au hasard des guerres, des invasions, des mutations économiques. Elle le fait par secousses. Mais à chaque mouvement, une arrière-garde s’est attardée, a fait souche, depuis des siècles parfois, comme ces descendants de l’empire de Charles Quint. Je sais également que si l’on s’éloigne physiquement des Ardennes, on ne les quitte jamais. Ainsi Eugène Guillevic me raconta-t-il un jour son attachement ébloui et indéfectible au pays de Rocroi bien qu’il n’y eût que très peu vécu. Non, on ne les quitte jamais, sans doute en raison de la forte empreinte de son massif forestier, mais aussi de cet alliage de la fermeté d’une histoire commune et du vent du renouveau qui fait des Ardennais une véritable communauté dont la voix collective résonne avec un « fort accent ».
Voici Julien Gracq, un autre passant des Ardennes. Il y est déjà venu rapidement en 1947, il a filé en compagnie d’amis dans la vallée. Selon l’éditrice de ses livres dans la Pléiade, Bernhild Boie, il est tourmenté en 1955 par l’écriture difficile d’un roman qu’il laissera inachevé, La Route (dont il publiera quelques pages dans La Presqu’île en 1970). Un jour d’octobre de cette même année, il débarque du train à Revin et parcourt à pied les quelques vingt-cinq kilomètres qui le séparent de Monthermé, via les Hauts-Buttés. De cette journée va naître Un Balcon en forêt. C’est le secret de cette marche qui anime son écriture ; c’est le « gâchis » (le mot est de Gracq) de savoir et de rêverie, de prégnance du corps pensant dans le lieu vivant qui nourrit le livre. En effet, si cette promenade s’inscrit déjà dans le processus de l’écriture du récit et opère comme un stimulus, le réel a déjà été imaginé par une longue rumination qui trouve son origine dans le vague désir de faire revivre la drôle de guerre que l’auteur a vécue en Lorraine, puis dans les Flandres avec le 137 RI parti de Quimper en 1939. Cette période, Gracq l’a plusieurs fois évoquée dans d’autres livres, en insistant notamment sur cette situation pour le moins insolite d’une armée en guerre occupée au farniente tandis que les civils de l’arrière n’ont rien changé à leurs habitudes de la paix.
Et pour lui, communiste qui a quitté son parti à la suite du pacte germano-soviétique, la blessure est double : c’est la fin de l’engagement politique en même temps que la découverte d’une armée fragile et gangrenée par les incohérences les plus accablantes. Il a également rappelé l’importance pour la genèse du livre, d’un court extrait du chapitre XIV des Communistes, quand Aragon y révèle sur le front endormi des Ardennes, l’existence de la maison-forte, « chalet comme un jouet d’enfant », « maisonnette pimpante pour conte de fée » (Gracq parle d’ailleurs dans son livre d’une « forêt de conte »). Aragon ajoute aussi que « trois hommes et un aspirant sont là-dedans (…) on appelle ça une maison-forte, et ça en fait couler de l’encre ». Il ne croyait pas si bien dire.
Après le château d’Argol que des touristes téméraires s’obstinent à vouloir visiter, l’Hôtel des Vagues d’un Beau ténébreux et « l’espèce de forteresse ruineuse » des Syrtes, Gracq trouve avec elle le réceptacle dans lequel il peut déposer ses personnages tout occupés à délivrer sa capacité imaginative.
[…]
Extrait de l’ouvrage : Balade dans les Ardennes, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, 2004.