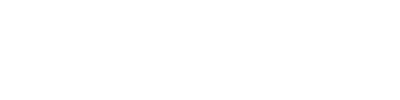Divers
Les Baux Suarès
Les Baux, Marseille
André Suarès
Marsilho, grecque et provençale
par Madeleine Villard
Il faut l’avouer, la vie de l’esprit est étrangère à cette forte ville.
Né à Marseille d’un père génois et d’une mère parisienne, André Suarès y a passé son enfance et son adolescence, y a vécu une période difficile après son échec à l’agrégation – lui, normalien, lauréat du concours général ! Enfant, c’est à Marseille qu’il a perdu sa mère, jeune homme, il y perd son père. Ce n’est pourtant pas cette ville qu’il a choisie pour y reposer, mais Les Baux où, outre l’amitié de Louis Jou, il a trouvé le charme provençal que Marseille lui semblait avoir perdu. Marsilho, un court volume paru en 1931, exprime les sentiments passionnés et excessifs qu’il porte à sa ville.
Il n’a cherché à faire ni la géographie de Marseille, ni son histoire, ni la description de ses monuments, ni un essai sur le caractère ou la culture de ses habitants, ni l’éloge de ses grands hommes ; il ne s’est pas non plus proposé de raconter les souvenirs de sa jeunesse marseillaise. Pourtant, Marsilho est tout cela, et bien plus. Dans un désordre apparent l’auteur entraîne son lecteur tantôt dans un quartier de la ville (cours Belsunce, Grand’rue, Roucas blanc), tantôt auprès des plus célèbres de ses fils (Puget, Daumier), tantôt devant un monument (Saint Victor, le château Borély, la Bourse) : ni description, ni récit, encore moins guide. Suarès, alors âgé de plus de soixante ans, semble avoir voulu livrer au lecteur, et surtout à la postérité, la nature profonde de Marseille, telle qu’il l’avait perçue dans sa jeunesse. Essentiellement subjectif est donc l’ouvrage ; il peint, bien sûr, des réalités du Marseille d’entre les deux guerres, mais surtout – c’est là qu’il est irremplaçable – il révèle la résonance intime de ces réalités dans l’âme de l’écrivain, on pourrait dire du poète.
Dans une lettre à son ami Paul Azan il proclame un noble projet, celui de rendre à Marseille « son caractère antique et sa nature provençale ». Tout en se plaignant amèrement d’être méconnu dans sa ville, il déclare « de toutes les villes illustres, Marseille [est] la plus calomniée ». On entrevoit donc son propos : malgré les cinglants reproches dont il va accabler la ville et ses habitants, il veut en entreprendre la réhabilitation. Mais là où un autre aurait entamé un raisonnement bien étayé, voire un panégyrique, Suarès, lui, exprime une passion. De la passion, son écrit a la démesure, les partis pris, tour à tour l’exaltation et le mépris. Sa ville, il la voudrait parfaite, dans sa vraie nature grecque et provençale, et il la trouve défigurée par des monuments hideux ; il y voudrait des artistes, des projets, il y voit des commerçants qui ne savent pas apprécier ceux que pourtant elle a produits ; cependant il admire sa puissance de vie et avoue y avoir senti « combien l’art est peu de chose au prix de la vie… Pour haïr Marseille, il ne faut pas aimer la vie ». Cet amour à la fois lucide et impitoyable se traduit par une sainte fureur ; il y a du poète, mais aussi du prophète dans ces pages…