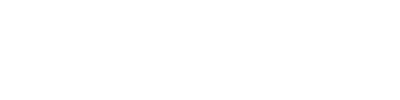Divers
ETREPILLY CHRISTIAN DE BARTILLAT
ETREPILLY
Christian de Bartillat, aux racines du fantastique
(extrait)
Il y a quelque quarante ans, nous nous sommes installés à Étrépilly dans une maison que nous avons achetée sur un coup de foudre. Une maison de notable, de notaire, avec un petit côté George Sand, qui lui confère une sorte de poésie insolite. Tout à côté, donnant sur un jardin, le clocher de l’église est comme un dernier arbre de pierre du parc. En somme tout ce qui est nécessaire au bonheur, à condition de pouvoir s’y refaire une seconde enfance. C’est là que je me suis mis à oublier l’autre, la maison ancestrale, hérissée de mâchicoulis, pour vivre dans une maison assez grande, bien que de moindres dimensions, dans la démocratie nouvelle de mes rêves et la paix familiale. Les maisons sont comme des êtres humains, en fonction peut-être de leur construction, de leur orientation, des personnes qui y ont vécu avant vous, des fantômes et des morts qui les hantent, des caves et des greniers qui les envoûtent. Il y a des maisons du bonheur et d’autres qu’on ne peut jamais habiter longtemps car elles provoquent la folie ou le malheur, ou elles tuent. La nôtre, jusqu’à présent, a été la bonne fée qui prodigue la paix. Elle est une personne, et c’est parce que nous la tenons pour une personne qu’elle nous aime autant que nous l’aimons.
Bien que mon épouse soit originaire de la région, je n’y ai, en ce qui me concerne, aucune attache locale. Je suis un homme issu des bocages du Centre, avec leurs petits champs fermés, et j’eus dès l’abord quelque inquiétude, quelque vertige même, à me promener dans ces immenses plaines moutonneuses d’un Multien qui, derrière les collines de la Goële, apparaît vraiment comme un début d’Eurasie. C’est une partie où le blé et le ciel sont les thèmes permanents d’un paysage auquel de lourdes fermes et des clochers massifs donnent régulièrement quelques assises.
Un peu las de tourner en rond dans ce parc où les arbres ne me donnaient rien de la plaine inspirée et voisine, je m’intéressais un peu au village, dont le maire était à l’époque un fermier poète, qui me fit amitié. Je ne tardais pas, au gré d’une élection, à entrer au conseil municipal et, quand le fermier poète quitta le village, après bien des péripéties, je fus son successeur. Ainsi je pénétrais peu à peu dans toutes les maisons, j’appris à connaître des hommes que la maudite ségrégation sociale de notre temps ne m’avait jamais permis de connaître. J’essayais tant bien que mal de me faire ici des amis. J’appris vraiment à connaître un village, à réfléchir à sa destinée. L’église, la poste, l’école étaient vraiment la chose du peuple et je commençais à écrire l’histoire de cette microcivilisation, en espérant que ce passé m’intégrerait peu à peu dans le présent d’un groupuscule éclaté.
Éditeur, ne voyais-je pas, tout au long de la semaine, des célébrités internationales, n’allais-je pas à New York, à Tokyo, n’étais-je pas en contact avec toutes les idées qui bouleversent le monde, venant heurter mes oreilles, venant agresser mon intelligence et bouleversant finalement mon coeur ? Là, au contraire, le samedi et le dimanche, je perdais la notion du temps pour me retrouver dans une France éternelle comme la mère, le père, la ménagère, le grand entrepreneur de plomberie, le conseiller, le défenseur, l’infirmier, l’homme au contact des hommes. Étrépilly–New York, ce fut pendant dix ans ma destinée. Mais bientôt le village ne me suffit plus, et au-delà de lui les campagnes, les autres villages, la région elle-même commencèrent à m’apparaître. Éditeur en semaine, je me mis à devenir, le samedi, l’historien d’un pays que j’aimais tant qu’il me fallait maintenant le connaître tout entier. Pendant cinq ou six ans j’arpentais la campagne, j’ouvrais les anciennes routes romaines, je rentrais dans toutes les églises, je montais dans beaucoup de greniers. Mes enfants et moi-même nous glanions, en février, dans les labours les tégulae et les silex qui nous apprenaient que ce pays était aussi vieux que le monde. Je me mis à collectionner brochures, livres, catalogues, plans, gravures, cartes postales, en somme tout ce qui contribuait à me livrer véritablement le passé non plus seulement à la porte mais à l’intérieur même de ma maison. Cette collectionnite, maladie bien moderne, m’envahit et de longtemps je ne rentrais plus chez moi que je n’aie trouvé ou cru trouver un opuscule arraché, quel qu’en soit le prix, à n’importe quel bouquiniste.
[…]
Extrait de l’ouvrage : Balade en Seine-et-Marne, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, mars 2002