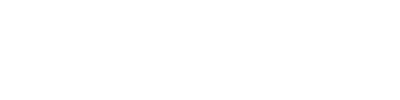Divers
Eragny Bernardin de Saint-Pierre
Eragny
Une chaumière et un cœur
par Edouard Guitton
(extrait)
Un veuf ronchon flanqué de deux loupiots peut-il encore trouver le bonheur à soixante ans
passés ? Tout arrive ici bas, même l’improbable.
A l’âge où d’autres pratiquent l’art d’être grand-père, M. de Saint-Pierre (Bernardin n’est que le troisième de ses prénoms) retombe en jeunesse et convole en un mariage d’amour ; elle a quarante-trois ans de moins que lui, elle pourrait être sa petite-fille. N’importe : ils s’aiment et se le prouvent. à vingt ans elle ne se contente pas de lui donner un troisième enfant ; elle s’occupe comme une mère des deux du premier lit car elle a un cœur d’or ; elle épaule admirablement son mari car elle est aussi femme de tête, énergique, décidée, cette Désirée de Pelleporc, alors que la précédente, Félicité Didot, pourtant aussi fraîche, ne savait que se déprécier et geindre et se lamenter sur le thème «je n’étais pas celle qu’il te fallait».
Bernardin, lui, jubile comme Adam avant le serpent, déborde de joie sensuelle, à croire qu’il avait jusque-là tout refoulé dans ses profondeurs. Le rêve rousseauiste de bonheur dans une habitation (mot clé) simple avec une compagne aimée l’a toujours possédé, chimère sans cesse renouvelée : ce fut, à douze ans, l’île de Robinson ; plus tard la colonie qu’il fonda près de la mer d’Aral, ou bien en Amazonie ; ou encore, au gré de ses voyages, les couples qu’il rencontrait vivant comme des ermites, heureux de leur solitude et de leur frugalité. Pas d’âme plus casanière que celle de ce faux nomade qui a vagabondé si durablement à la recherche d’un emploi impossible et d’aventures fastueuses, rêvant d’amour et de fortune et ne récoltant que désillusions alors qu’il n’aspirait qu’à cultiver son petit jardin. Un jour il rima Mes souhaits sur le rythme de la romance, celui-ci entre autres :
«Si le ciel, à mes vœux faciles,
Me donnait le choix d’un asile,
J’irais vivre dans un hameau.
Un champ, un bois près d’un ruisseau,
Un petit toit couvert de paille,
Seraient mon Louvre et mon Versaille…»
Il mit du temps à parvenir à ses fins. L’inadaptation sociale, les Saint-Pierre l’avaient dans le sang : on parlerait aujourd’hui de neurasthénie ou de déprime. Un de ses frères deviendra fou ; son unique sœur Catherine macère dans un célibat morose, et c’est encore l’aîné, Bernardin, bourlingueur et quémandeur grincheux, qui s’en tire le mieux parce que la nature lui a donné cet exutoire providentiel : la démangeaison d’écrire. Mais à quel prix réussira-t-il ! La notoriété, chèrement acquise après tant d’années de galère, lui vient avec les Etudes de la nature (1784, il a quarante-sept ans), espèce de somme ou de symphonie descriptive, adressée à tous les déshérités de la terre, vaste public. Quatre ans plus tard, M. de Saint-Pierre se paye le luxe de produire un chef-d’œuvre comme il n’en paraît pas deux par siècle. Paul et Virginie 1 sort en librairie le 25 mars 1788, joyau tiré des entrailles de son géniteur, fruit d’une très longue maturation dont il dira : «Ce roman contient toute ma philosophie.» La merveille devait faire vibrer bien des admirateurs, de Chateaubriand à Flaubert, de Lamartine et Sainte-Beuve à Jean Cocteau, tous subjugués, rendant les armes.
[…]
Extrait de l’ouvrage : Balade en Val-d’Oise, sur les pas des écrivains, Alexandrines, avril 1999