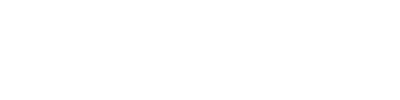La Seine et Marne des écrivains
Henry Murger à Bourron-Marlotte
BOURRON-MARLOTTE
Henry Murger, le romancier de la Bohème
par Luce ABÉLÈS
(extrait)
« Revu Marlotte, à côté d’ici, que nous n’avions pas vu depuis dix ans, lorsque nous y allâmes avec Peyrelongue, le marchand de tableaux, Murger et sa Mimi, etc. Nous retrouvons le village, mais maniéré, avec des espèces de pauvres petites maisons bourgeoises, des efforts de bâtisses, des tentatives de cafés – un pissoir même ! […] Au tournant d’une masure, […] une figure de père La Joie crapuleux, les pieds à cru dans des chaussons, vient serrer familièrement la main de notre compagnon, Palizzi : c’est Antony, l’hébergeur des bas peintres. […] De la salle de billard, nous mettons le nez dans la salle à manger, toute peinturlurée de caricatures de corps de garde et de charges de Murger. […] En revenant, on nous montre la maison de Murger, à l’entrée, vers la forêt ; puis l’ami de Murger, Lecharron, un marchand de vin, qui nous dit d’un ton attendri : “Ah ! ce pauvre Murger ! Tenez, c’était là que je lui ai fait bien souvent une omelette ! Il passait tout son temps ici…” Et puis il ajoute avec un soupir : “J’ai perdu bien de l’argent avec lui ! Au lieu de lui faire un si beau tombeau, on aurait dû payer ses dettes. Ça aurait fait plus d’honneur aux artistes !” Murger ! Antony ! Ce mort et cette auberge, tout cela me semble aller ensemble. Marlotte maintenant, avec ses faux artistes et ses fausses Mimi en garibaldis rouges et bleus, me semble fait pour être sous l’invocation de saint Murger ! Sa mémoire insolvable flotte ici dans un goût d’absinthe1. »
À lire ces notes désabusées des frères Goncourt, alors en villégiature dans la forêt de Fontainebleau pour préparer un roman sur les peintres, qui paraîtra quatre ans plus tard sous le titre de Manette Salomon, on aura compris que Murger a partie liée avec la forêt et avec une certaine image de la vie d’artiste. On retrouve cette association dans l’ambitieux portrait de groupe peint à Marlotte par Auguste Renoir en 1866, le Cabaret de la mère Antony : dans cette même auberge traitée de haut par les frères Goncourt, des artistes amis devisent autour d’une table, servis par la fille de la maison, tandis que sur le mur se détache la silhouette caricaturale de Murger, saint patron dérisoire du lieu, graffitti évoqué par les Goncourt et dont Renoir revendiquera la paternité.
Une question revient alors, insistante : quel est cet homme, Murger, dont la mémoire hante durablement le village de Marlotte, associée aux groupes de peintres qui y vinrent travailler sur le motif ? Parisien de naissance – il est le fils unique d’un concierge tailleur –, l’écrivain Henry Murger (1822-1861) appartient à la génération qui succède à la brillante floraison romantique. Il fait partie de ce bataillon d’artistes et de littérateurs d’origine modeste, souvent provinciale, qui ont en commun la volonté de se frayer un chemin dans le champ culturel, alors que rien ne les y prépare. Sans formation initiale, sans soutien familial, sans fortune et sans relations, ils doivent lutter pour se voir reconnus, en butte à la misère et au découragement. Un moyen s’offre pour se faire un nom : devenir feuilletoniste dans la petite presse, en plein essor sous la monarchie de Juillet. C’est dans cette voie que Murger s’engage résolument. Il entre bientôt dans un petit journal aux pratiques douteuses et au titre sulfureux, le Corsaire Satan, où débute une pléiade de jeunes talents prêts à dépenser des trésors d’esprit pour se voir imprimés. Baudelaire, Banville, Champfleury, Nadar y font leurs premières armes, développant cet esprit de mots à l’emporte-pièce, mélange d’ironie et de paradoxe, caractéristique du style de la petite presse. C’est là que Murger publie en feuilleton, à intervalles irréguliers, les Scènes de la vie de bohème. Ces saynètes à la trame assez lâche sont la transposition burlesque d’une réalité vécue : la misère, l’hôpital, les amours de passage forment la toile de fond de l’existence de ces marginaux, aspirants artistes et littérateurs, qui usent d’expédients en attendant une gloire hypothétique, s’éprenant de jeunes filles aux mœurs aussi légères que leurs surnoms – Musette, Mimi, Phémie… – qui les aiment et les quittent au gré de leurs besoins et de leur fantaisie. L’apparition du musicien Schaunard, au premier chapitre des Scènes, situe bien le ton du récit, qui par la blague travestit en bouffonnerie une réalité douloureuse :
« Pour se garantir des morsures d’une bise matinale, Schaunard passa à la hâte un jupon de satin rose semé d’étoiles en pailleté, et qui lui servait de robe de chambre. Cet oripeau avait été, une nuit de bal masqué, oublié chez l’artiste par une folie qui avait commis celle de se laisser prendre aux fallacieuses promesses de Schaunard, lequel, déguisé en marquis de Mondor, faisait résonner dans ses poches les sonorités séductrices d’une douzaine d’écus, monnaie de fantaisie, découpée à l’emporte-pièce dans une plaque de métal, et empruntée aux accessoires d’un théâtre. »
[…]
Extrait de l’ouvrage La Seine-et-Marne des écrivains (c) Alexandrines, 2015