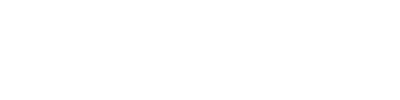Divers
Auderville Goury Decoin
AUDERVILLE, GOURY
Ma préférée française,
par Didier Decoin
(extrait)
Je n’avais que huit ans lorsque j’assistai à une projection du Salaire de la peur d’Henri Georges Clouzot. Mon père m’y avait conduit parce que ce rude et beau film dédié au courage, et sans doute aussi à la folie des hommes, était supposé faire leçon pour le petit bouffon que j’étais. Ce n’est pourtant pas l’héroïsme des chauffeurs pilotant des camions de nitroglycérine susceptibles d’exploser à la moindre ornière qui me laissa le souvenir le plus impérissable, mais la scène finale où l’on voit Yves Montand respirer voluptueusement un vieux ticket de métro fétiche dont le fumet poivré (odeur de vêtements pluvieux, de sueur, de métal chaud) lui rappelle Paris dont la vie l’a éloigné – et dont la mort, dans une fraction de seconde, va le séparer à jamais.
Si je dois à mon tour me perdre un jour à des milliers de kilomètres de la France, ce n’est pas un ticket de métro que j’emporterai pour couver – et cuver – ma nostalgie : mon viatique sera l’image (photo, dessin, peut-être une page de Maupassant) d’une campagne d’un brun lourd et profond, avec de grassouillets labours nappés de brumes crémeuses, avec les joncs gris des clochers qui font tourner au vent leurs embrochées de coqs zingués, les villages arrondis qui mûrissent et se tassent lentement sous la croûte mordorée de leurs toitures en tuiles, avec tout au bout la mer comme une de ces fourrures que l’on jette en vagues au pied du lit des reines – car c’est bien d’une reine qu’il s’agit, ma reine de France à moi, la Normandie (ou plutôt les Normandie puisqu’il paraît qu’elles sont deux), ma référence et ma préférence françaises.
J’avais deux ans lorsque mon père, sur un coup de tête, acheta une ferme passablement décatie entre Vernon et Pacy-sur-Eure. La maison sentait le hibou, ses volets pendouillaient, ses cheminées étaient bouchées par des maçonneries d’hirondelles, et sa cour éventrée était si désespérément glaiseuse qu’on ne pouvait la traverser qu’en adoptant le pas des patineurs.
Dès lors, c’est vers elle que nous emporta chaque été la 15cv Citroën au long capot de squale noir. Ainsi n’ai-je longtemps connu de la Normandie que son visage d’été, ce sabbat de hannetons, de fétus de paille et de nuages fessus voletant dans l’air bleu.
C’est dans ses chemins crayeux, à travers la nasse de ses ronceraies, sur ses mamelons qui violaçaient sous les orages d’août, que j’ai appris que le plus beau des mondes est moins celui qui est que celui qu’on s’invente.
[…]
Extrait de l’ouvrage : Balade dans la Manche, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, mars 2006.